Le monde du sonore a ses penseurs. L’un des plus éminents est le docteur en esthétique Roberto Barbanti. Professeur au département Arts plastiques de l’Université Paris 8, il réfléchit aux questions d’écologie sonore depuis plus de 20 ans. En témoigne la parution récente d’un recueil d’articles parus entre 2006 et 2017 : Les sonorités du monde. Dans un café parisien remarquablement bruyant, il revient sur la revue qu’il a animée et résume les idées qu’il y a exprimées…
Commençons par le commencement : l’origine des 8 articles réunis dans ce livre. Ils sont parus dans la revue « Sonorités ». Quel était l’objectif de cette revue ?
Roberto Barbanti : « L’objectif était d’approfondir la question de l’écologie sonore. Il n’y avait pas de revue francophone à ce sujet. Il n’y avait que Soundscape, une revue anglophone liée aux travaux de Raymond Murray Schafer et au mouvement international qu’il avait animé depuis les années 1970. Pierre Mariétan et moi avons lancé cette revue en 2006. Pierre est un compositeur suisse qui vit à Paris, auteur d’une œuvre importante, à la fois dans le domaine instrumental et dans celui des arts sonores. Moi, je venais d’Italie, j’étais arrivé en France depuis longtemps. J’étais en contact avec le mouvement italien de l’écologie sonore, parce que j’avais étudié avec Albert Mayr qui était professeur de musique électronique, électroacoustique, au conservatoire de Florence. Il avait travaillé, lui, avec Murray Schafer, au Canada, où il avait enseigné. Il avait collaboré avec Murray Schafer sur le projet Five soundscape villages, vers 1975. Il y a eu une rencontre internationale, ici, à Paris, à L’École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette (ENSAPLV), en 1996 où j’ai rencontré Pierre Mariétan. On a fondé la revue ensemble. Grâce à Pierre, on avait la possibilité d’organiser des rencontres sur l’écologie sonore en Suisse. On avait donc des traces de nombreuses interventions d’artistes, de chercheurs, de musiciens ; on voulait les valoriser. Cette revue devait être un lieu d’échanges, de débats, de réflexion, autant qu’un outil de diffusion de nos idées sur l’écologie sonore. La revue s’est arrêtée en 2017, après le numéro 11. »
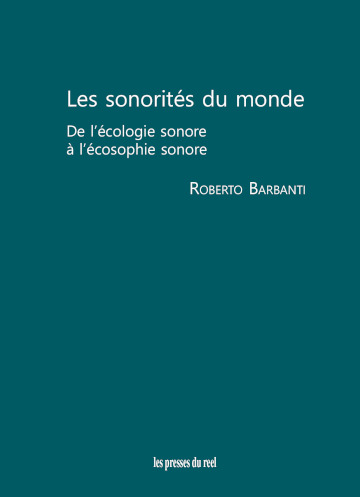
Autant le nom de Raymond MurraySchafer est connu, autant celui de Pierre Mariétan mériterait d’être mis en lumière. Pour beaucoup, il est surtout associé à l’architecture. C’était son principal sujet de recherche ?
Roberto Barbanti : « D’une certaine façon… Travailler sur l’écologie sonore, nécessairement, mène à travailler sur la sonosphère, sur la ville, sur les nuisances sonores. Pierre a travaillé sur ce sujet à l’école de La Villette (ENSAPLV). Il a créé un laboratoire qui s’appelle « LAMU » (Laboratoire d’Acoustique et de Musique Urbaine). J’y ai travaillé moi aussi et, pendant un certain temps, j’en ai été également le directeur scientifique. La question de l’architecture est fondamentale pour l’écologie sonore. Le son est une vibration qui réagit dans un espace donné. Chanter dans une chambre anéchoïque, chanter dans une cathédrale gothique ou chanter dans un tout petit appartement donne trois résultats totalement différents. Aujourd’hui, il existe des logiciels capables de recréer la réverbération d’un espace mais, bien évidemment, l’espace matériel, physique, réel, est tout autre chose. »
Au cœur de la plupart des textes que vous rééditez, on retrouve l’idée que l’Occident est porteur d’une sensibilité particulière, qui privilégie le regard et néglige les autres sens. Vous utilisez l’adjectif « rétinien » pour décrire notre civilisation…
Roberto Barbanti : « Moi, je viens aussi des arts plastiques (j’ai fait des études de musique, mais j’enseigne dans un département d’arts plastiques) et j’ai emprunté l’adjectif « rétinien » à Marcel Duchamp. Il indiquait par là la dimension réductionniste de la vision. La dimension rétinienne, c’était, pour lui, la pure perception, autrement dit la simple donnée physique. Lui pensait aussi à la dimension conceptuelle de la vision. L’œil est un organe réceptif, physique, mais il est lié au cerveau, aux neurones, à l’expérience. Il y a l’œil et il y a le regard. L’œil et le regard se conditionnent réciproquement. Moi, j’utilise les termes de « paradigme rétinien » pour décrire la civilisation occidentale à partir de la culture grecque. Ce primat de la vision a été repris par les Romains. À la Renaissance, avec la modernité épistémologique et philosophique, il y a un changement qualitatif important et la force du rétinien s’est accrue. Certains philosophes, comme Gilbert Hottois, parlent d’une civilisation « logothéorique » : le « logos », c’est la pensée, le parler, la « theoria », c’est la contemplation, la vision… Une civilisation logothéorique, c’est une civilisation qui pense le monde à partir de l’œil. Cette question sensorielle est fondamentale. L’esthétique occidentale a eu tendance à éliminer les sens, en quelque sorte. La dimension sensible des humains (mais aussi celle des animaux) a été secondarisée. On a valorisé la production, les œuvres, en tant qu’expression d’un sujet, mais pas le sentir. Notre tradition épistémique ne tient pas compte du sensible, qui, selon les scientifiques et les philosophes modernes, n’a aucun fondement (« On ne discute pas des goûts et des couleurs » dit-on ici). Penser en termes sensibles est devenu, même au niveau philosophique, très improbable. Notre pensée est essentiellement axée sur le raisonnement logique, sur l’observation visuelle des phénomènes, qui les isole et les sépare dans l’espace pour les quantifier. Parler en termes sensibles est une forme de discours qui semble amener à de la partialité, donc à des erreurs. Il faut réintroduire le sensible dans la pensée. Le sensible implique le qualitatif ; or, le qualitatif est fondamental pour comprendre le vivant. Je propose un autre paradigme que le paradigme rétinien : le « paradigme de l’écoute ». Il faut effectuer une transition époquale, passer de l’époque des Lumières à l’époque des Sonorités (sans exclure les Lumières), de façon à aboutir à une forme de pensée qui tienne compte du sensible. Il faut aller vers le « sentir-penser » dont certains anthropologues parlent en faisant référence à des peuples de l’oralité primaire, qui sont souvent natifs de l’Amérique du Sud. Pour eux, la dimension de la pensée, la raison, n’est pas séparée de la dimension sensible. Réintégrer ces deux univers est fondamental. Réintroduire la dimension des percepts et des affects, réintroduire la question de la qualité du monde, permet d’atteindre une sorte d’objectivité dans la lecture du réel qui n’est pas réductionniste, qui dépasse cette raison instrumentale qui est aujourd’hui la raison du marché et de l’écologie superficielle. C’est pour ça que je parle d’ « écosophie » et non pas d’écologie. »
Comment les effets de la vue pourraient-ils être contrebalancés par un autre sens, l’ouïe ?
Roberto Barbanti : « Il y a une prémisse à faire. L’ouïe et la vue font partie du sensorium. Le sensorium d’un humain, c’est l’ensemble des différentes formes perceptives qui travaillent ensemble, qui interagissent, qu’on ne peut pas séparer. Je ne peux pas séparer l’audition de la vision, le toucher de l’odorat… Ma position n’est pas réductionniste, je ne propose pas de remplacer la vision par l’ouïe. Ce qui m’intéresse, c’est la dimension polysensorielle, multiple, de l’ouïe. L’ouïe renvoie à l’audition, elle renvoie à la perception haptique (mon corps perçoit les vibrations) mais elle renvoie aussi à la production du sujet qui parle. Nous produisons du son, pas de la lumière. J’invite à une transition de la dimension monosensorielle du regard à la dimension polysensorielle de l’ouïe. Je ne veux pas un monde de personnes non-voyantes, je veux continuer à voir et écouter le monde. Alors, compte tenu de la complexité de notre histoire, de notre tradition culturelle, comment va-t-on transformer cet Occident rétinien ? On doit de toute façon le transformer, parce que notre culture est mortifère. Elle nous a conduit au désastre. Elle est impérialiste et l’impérialisme des sens passe essentiellement par la vision. Comment penser autrement ? En réintroduisant dans la pensée une dimension sensible capable de porter la complexité. Il me semble que la dimension sonore, la dimension de l’écoute est la métaphore la plus appropriée pour parler de la complexité, de la multidimensionnalité et de la polysensioralité. Mais il y a beaucoup d’autres raisons… L’écoute est la seule forme de perception qui, à la fois, est immersive, touche les choses et peut se positionner à distance. La vision fonctionne avec la lumière. La lumière, c’est une dimension ondulatoire dont nous pouvons nous séparer si on ferme les yeux. On peut aussi être dans un milieu totalement obscur, sous terre, par exemple. Je peux m’isoler de la lumière mais pas du son. Ce n’est pas une vibration qui rebondit sur des objets, comme la lumière, et qui me permet de voir ces objets. Le son, c’est le milieu ondulatoire. Dans ce café, j’entends la somme de toutes les vibrations. J’entends la voix d’un homme qui parle à la table d’à côté mais ce n’est pas un objet isolé. Cette émission sonore coexiste avec les autres vibrations présentes. Toutes créent des formes d’ondes, des processus de condensation et de raréfaction moléculaires de l’air, qui arrivent, dans leur globalité, à mon tympan. Mon oreille est capable de discriminer, d’écouter l’homme qui parle à côté sans effacer la voix de la serveuse ou le bruit des verres. Depuis que je suis né (et même avant ma naissance), je perçois ce flux sonore du milieu. Le milieu, d’ailleurs, ne se limite pas à l’air : je peux entendre sous l’eau et, si je colle mon oreille sur le sol, je peux entendre un cheval qui arrive au loin (enfin, dans certains endroits). La dimension du sonore annihile la distinction occidentale entre le sujet et l’objet. Parler en termes de sons veut donc dire parler en termes d’effacement de toute notion de séparation. La vue, elle, se base sur la séparation. Elle n’admet aucun contact : si je place ma main devant mon œil, je ne vois plus. Elle opère par focalisation. Notre regard est celui d’un prédateur : les yeux sont placés à l’avant de la tête, ils sont parallèles, ils peuvent se focaliser sur une proie. La vue assigne. Quand je regarde autour de moi, je me dis « ça, c’est une bouteille », « ça, c’est un verre », « ça, c’est un bloc-notes »… L’oreille, elle, perçoit le milieu dans sa totalité. Si on s’arrête quelque part et qu’on ferme les yeux, qu’on se met à écouter, on a l’impression que le milieu nous traverse. Alors que la vision nous place dans l’espace, à un point précis, et que le milieu devient un environnement. La notion de sujet devient alors très forte. C’est pour cela que je n’utilise pas le mot « environnement », que je ne parle pas de « musique environnementale » mais plutôt de sonosphère, de paysage sonore… »
Lire la seconde partie de l'entretien
Photo de têtière : François Mauger
Pour aller plus loin... La page consacrée au livre sur le site web de l'éditeur Le site web du groupe de recherche Arts Ecologies Transitions, auquel Roberto Barbanti appartient

[…] de pollution sonore, donc d’écologie ou d’écosophie sonore pour reprendre les termes de Roberto Barbanti. Sur un site participatif dédié (Anthropophony); Caroline à invité des contributeurs à […]